

February 5, 2026
7
min de lecture
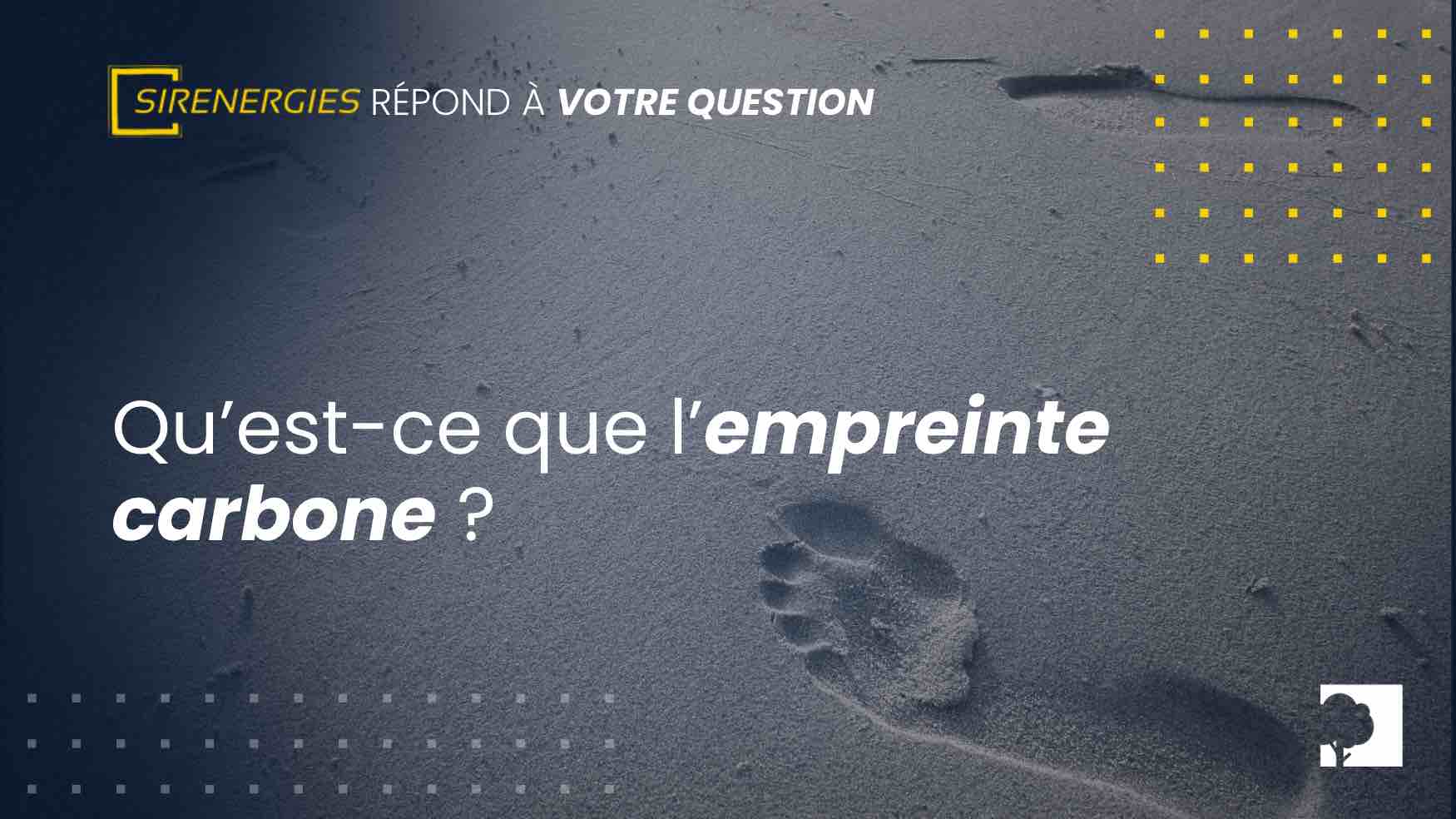
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont la principale cause du réchauffement climatique. Les réduire est une priorité pour maîtriser la hausse des températures et atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 défini par l’Accord de Paris.
Toutes les entreprises peuvent agir et participer à l’effort collectif. Mais comment connaître les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre et prioriser les actions ? L’empreinte carbone est la réponse. Voici quelques pistes pour mieux comprendre l’empreinte carbone et évoluer vers un bilan carbone plus vertueux et respectueux de l’environnement.
L’empreinte carbone est née à la fin des années 1990, dans le prolongement du protocole de Kyoto de 1997 qui contraignait les pays à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre. Le concept s’est développé dans les années 2000 pour s’imposer aujourd’hui comme un indicateur central de la lutte contre le réchauffement climatique.
L’empreinte carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités humaines. Elle peut se calculer au niveau d’un pays, d’un secteur, d’une entreprise ou d’un particulier.
Pour simplifier la compréhension et permettre la comparaison, l’empreinte carbone s’exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2eq pour tous les gaz à effet de serre. Car le dioxyde de carbone n’est pas le seul gaz responsable du réchauffement climatique. Le méthane (CH4) et l’oxyde d’azote (NO2) participent aussi au phénomène, ainsi que des gaz plus confidentiels : hydrofluorocarbure, protoxyde d’azote, perfluorocarbure et hexafluorure de soufre.
Inventée en 1992, l’empreinte écologique est antérieure à l’empreinte carbone. Elle consiste à évaluer le nombre de Terres nécessaires pour répondre aux exigences d’un mode de vie et de consommation. On estime par exemple qu’il faudrait 2,8 Terres pour absorber le mode de consommation d’un Français, 9 Terres pour un Qatarien et 0,3 Terre pour un Yéménite.
L’empreinte écologique a l’avantage de marquer les esprits. Mais elle donne peu d’informations concrètes sur les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre et les actions à prioriser.
Deux méthodes permettent de calculer l’empreinte carbone. Certifiées par l’ADEME, elles servent à mesurer l’impact carbone des pays, des ménages ou des entreprises, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie d’un produit.
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un facteur d’émission physique est privilégié dès que possible.
La formule de calcul est la suivante : Quantité GES = quantité consommée (exprimée dans l’unité du produit) × facteur émission physique (quantité de CO2 émise par une unité).
Par exemple, si une voiture électrique émet 0,1 kg de CO2 par kilomètre, on évalue à 5 kg CO2eq ses émissions de gaz à effet de serre pour un trajet de 50 km (50 km × 0,1 kg de CO2/km).
Le ratio monétaire mesure les émissions de dioxyde de carbone à partir du prix. Cette méthode est utilisée pour les services dont la quantité consommée est difficile à mesurer (télécommunications, maintenance, publicité, réparation de machines et équipements, etc.).
La formule de calcul est la suivante : Quantité GES = Prix × facteur émission monétaire (exprimé en kgCO2eq par k€ HT).
Par exemple, la Base Carbone de l’ADEME considère que les services de télécommunications émettent 170 kg CO2eq par k€. Si une entreprise dépense chaque année 10 000 euros dans ces services, on évalue leur impact carbone à 1 700 kg CO2eq.
En France, l’empreinte carbone est calculée en incluant l’ensemble des gaz à effet de serre liés à la demande finale intérieure. Elle prend en compte :
Selon les dernières données, l’empreinte carbone de la France était estimée en 2021 à 604 millions de tonnes équivalent CO2, soit 8,9 tonnes CO2eq par Français.
Si la France a vu ses émissions de gaz à effet de serre baisser de 9 % depuis 1995, son bilan carbone est alourdi par les importations. Celles-ci représentent 51 % de l’empreinte carbone nationale.
La méthode de calcul de l’OCDE diffère de celle de la France. L’OCDE ne prend en compte que les émissions de CO2 énergétiques, alors que la France inclut dans ses calculs les émissions de méthane et de dioxyde d’azote.
Selon les estimations les plus récentes en date de 2018, la France se classe parmi les meilleures élèves européens en matière d’émissions de gaz à effet de serre avec 6,8 tonnes CO2eq par habitant, contre une moyenne européenne de 7,8 tonnes CO2eq par personne.
Pour une entreprise, réduire son empreinte carbone est d’abord une action de transition énergétique « citoyenne ». Mais c’est aussi une stratégie commerciale. À l’heure où la politique RSE (responsabilité sociétale et environnementale) est de plus en plus scrutée par les consommateurs et investisseurs, un bilan carbone vertueux est un vrai avantage concurrentiel.
La sobriété énergétique vise à adopter au quotidien des « gestes climat » pour réduire la consommation d’énergie à la source. Simple, concrète et accessible à tous, la sobriété énergétique, c’est par exemple :
Retrouvez dans cet article quelques bons réflexes à adopter en entreprise.
L’efficacité énergétique consiste à privilégier des solutions moins énergivores pour couvrir un besoin de consommation, sans détériorer la qualité du service.
Investir dans la rénovation énergétique des bâtiments est l’une des actions les plus rentables. L’isolation thermique minimise les pertes d’énergie, optimise le chauffage et permet de réduire la climatisation, tout en maintenant le confort des salariés.
L’efficacité énergétique, c’est aussi remplacer les équipements par du matériel énergétiquement plus performant.
Photovoltaïque, géothermie, pompes à chaleur : de nombreuses solutions existent aujourd’hui pour accéder à une énergie renouvelable, locale et décarbonée. Avec la baisse des coûts des équipements et les aides financières, l’autoconsommation photovoltaïque s’impose comme une alternative performante et rentable pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, baisser sa facture d’énergie et sécuriser son approvisionnement.
Produire et consommer sa propre électricité renouvelable permet de réduire rapidement l’impact carbone de son entreprise. L’électricité photovoltaïque et la géothermie émettent en moyenne 44 à 45 g CO2eq/kWh contre 243 g CO2eq/kWh pour le gaz naturel ou encore 1 060 g CO2eq/kWh pour une centrale à charbon.
L’électro-mobilité professionnelle offre une solution pour s’affranchir des carburants fossiles polluants et coûteux. En moyenne, l’empreinte carbone d’une voiture électrique est inférieure de 20 à 60 % à celui d’une voiture thermique. Les offres commerciales rendent aujourd’hui abordable l’installation de bornes de recharge, couplées ou non à des ombrières photovoltaïques.
Côté transport lourd, le bio-GNV et l’hydrogène pourraient aussi être l’avenir d’une mobilité décarbonée. Le potentiel de ces gaz renouvelables et bas-carbone s’avère très prometteur pour les secteurs routiers, ferroviaires, aériens et maritimes.
Certaines émissions de CO2 ne peuvent pas être évitées. Pour les entreprises les plus consommatrices, des technologies se développent pour capturer le carbone dans l’air ou les fumées. Le CO2 peut ensuite être réutilisé ou stocké dans un puits de carbone naturel, les fonds marins ou encore un ancien gisement d’hydrocarbures. C’est le principe du CCUS (Carbon, Capture, Utilization, Storage).
Ces technologies n’en sont encore qu’au stade expérimental avec un début d’industrialisation espéré d’ici à 2030.
L’urgence climatique est là. Contre le réchauffement, chaque entreprise peut agir en réduisant son empreinte carbone. La première étape : réaliser un bilan carbone.
Ce rapport permet de mieux connaître ses émissions de gaz à effet de serre, d’identifier les activités et les équipements avec le plus fort impact sur le climat et d’établir un plan d’actions. L’empreinte carbone est un outil précieux pour les entreprises désireuses de s’engager dans la transition énergétique, vers un avenir durable et décarboné.
Pour aller plus loin sur le sujet, nous vous conseillons la lecture de cet article : La compensation carbone est-elle vraiment efficace ?

.png)

Il est possible de réduire votre facture énergétique de 10 à 15 % de manière immédiate sans réaliser de travaux lourds. Ces économies reposent exclusivement sur la sobriété énergétique et le changement de comportement des collaborateurs.
À titre d'exemple, le chauffage représente environ 50 % des consommations d'un bâtiment tertiaire : baisser la température de seulement 1°C permet de réduire la consommation de 7 %. De même, l'extinction systématique des lumières et la mise hors tension des équipements informatiques (ordinateurs, serveurs non critiques) permettent d'éliminer des gaspillages qui représentent souvent 40 % des dépenses inutiles.
.png)

La réussite d'un projet collectif énergie repose sur trois piliers fondamentaux :

