

February 25, 2026
7
min de lecture
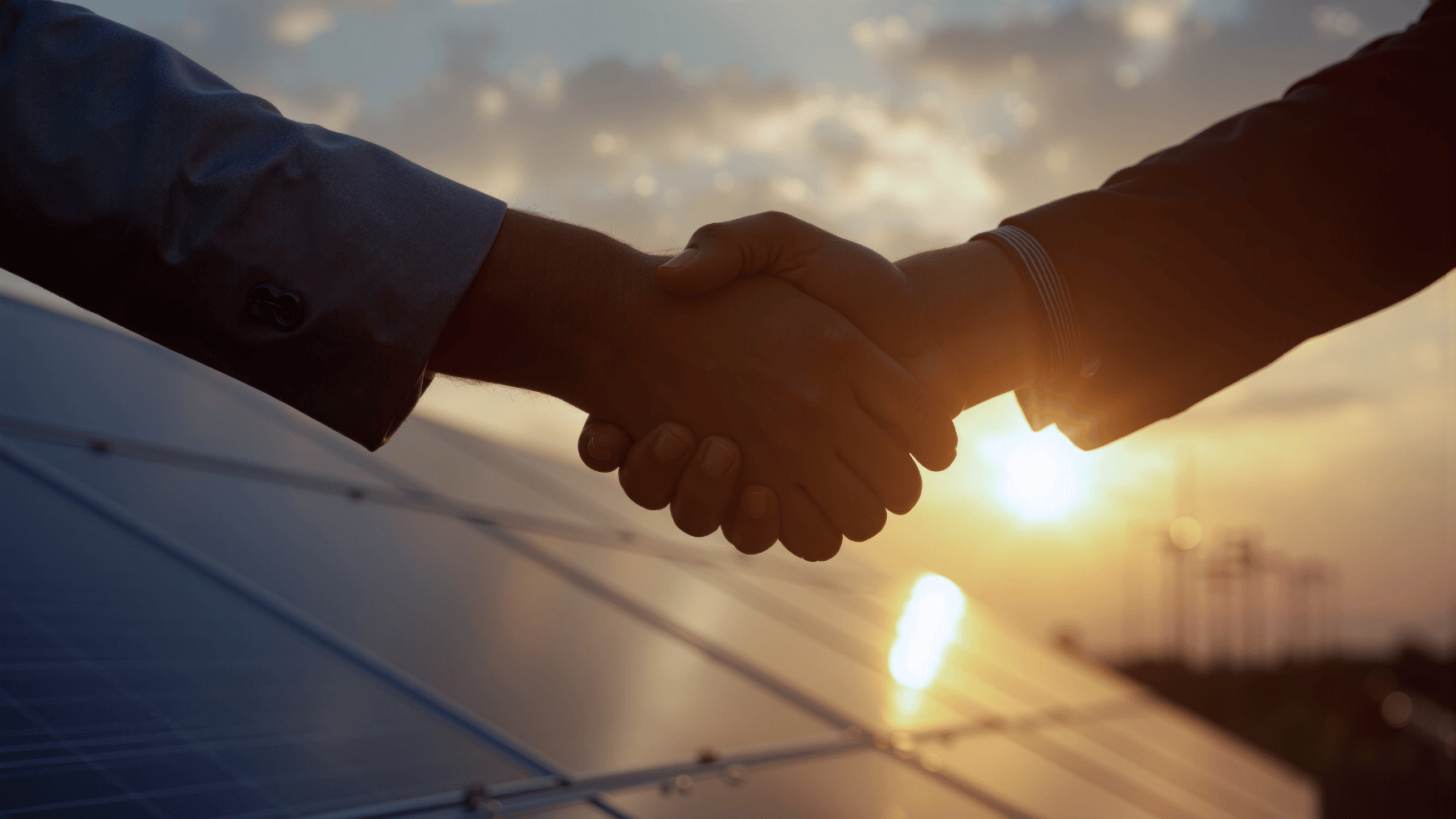
Mis à jour le : mercredi 3 décembre 2025
« De plus en plus complexe », « coûts de plus en plus importants », «importants phénomènes de fraude » : dans un communiqué du 17 septembre 2024, la Cour des Comptes n’est pas tendre avec le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) qu’elle appelle à réformer en profondeur.
Tout serait-il bon à jeter dans ce dispositif au cœur du financement de la transition énergétique en France ?
Ce qui est certain, c’est que les conclusions de la Cour des Comptes ont influencé les arbitrages de la sixième période des CEE 2026-2030.
Retour sur ce mécanisme detransition énergétique et ses perspectives d’avenir.
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) ont vu le jour en 2005, avec la loi de programme POPE du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. Avec ce dispositif, la France se plaçait alors à l’avant-garde de la transition énergétique.
L’objectif ? Inciter financièrement entreprises, professionnels et particuliers à réaliser des économies d’énergies.
Le mécanisme des certificats d’économies d’énergie est complexe. Au cœur du système : les acteurs obligés. On les appelle ainsi car ils ont l’obligation d’obtenir un certain volume de CEE pendant une période donnée, sous peine de sanctions financières. Ces certificats témoignent des quantités d’énergie économisées grâce à leurs actions.
Le volume des CEE est fixé par l’État par période. Il est partagé entre les acteurs obligés au prorata de leurs ventes d’énergie.
Les acteurs obligés sont les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz naturel, GPL, chaleur, froid, fioul) et les distributeurs de carburants. On compte parmi eux de grands noms comme EDF, Engie, TotalEnergies, Leclerc, Auchan ou Carrefour.
D’autres acteurs non obligés sont éligibles au dispositif. Ce sont les collectivités territoriales, les établissements publics, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et les bailleurs sociaux.
Pour réaliser des économies d’énergies et obtenir leur volume de CEE, les acteurs « obligés » ont trois possibilités :
Les CEE obtenus par les acteurs obligés sont directement délivrés sur leur compte EMMY dans le registre national numérique.
Depuis 2005, cinq périodes CEE se sont succédé. Les objectifs d’économies d’énergie se sont affirmés de période en période. L’augmentation de plus de 4 000 % des obligations entre 2005 et 2022 donne le vertige et traduit les ambitions de la France.
Lors du lancement du dispositif, l’État fixe un objectif d’économies d’énergie raisonnable de 54 TWh cumac (le kWh cumac est l’unité utilisée dans le calcul d’obligation). Cet objectif est largement atteint à l’issue de la période, avec plus de 65,3 TWhc économisés.
Suite au succès de la première période, l’objectif d’économies d’énergie augmente à 447 TWh cumac. L’élargissement du périmètre des acteurs obligés compense cette hausse spectaculaire, avec l’intégration des distributeurs de carburant.
L’objectif d’économies d’énergie est quasiment multiplié par deux. L’ambition est fixée à 700 TWh cumac, pour répondre aux exigences européennes en matière de réduction d’énergie.
Durant cette période, la standardisation des documents et un processus déclaratif de demande sont mis en place. Le CEE précarité naît. Il oblige à dédier 150 TWhc supplémentaires à la lutte contre la précarité énergétique.
L’objectif d’économies d’énergie, de 2 133 TWhc, suit toujours une courbe ascendante.
La quatrième période des CEE met en exergue certaines limites du système des CEE. La loi évolue pour lutter contre les fraudes. L’arrêté de contrôle du 28 septembre 2021 renforce les contrôles systématiques et aléatoires. Il durcit les exigences de qualité et abaisse le seuil des opérations non conformes autorisées.
Sur cette cinquième période, les objectifs atteignent 2 400 TWh cumac, en phase avec les objectifs européens et nationaux de transition énergétique.
Cette période est marquée par le renforcement des aides CEE aux ménages les plus modestes. La répartition des obligations entre les fournisseurs est également modifiée, illustrant la volonté de décarbonation de la France. Les fournisseurs de gaz et de fioul subissent une hausse respective de leurs obligations de 83 % et de 52 %, tandis que les fournisseurs d’électricité voient leur coefficient d’obligations baisser de 11 %.
En septembre 2024, la Cour des Comptes dressait un bilan mitigé du dispositif des CEE.
Même si elles seraient surestimées d’au moins 30 % selon les estimations de la Cour des Comptes, de réelles économies d’énergie ont été réalisées depuis 2005 grâce à l’accélération des travaux d’efficacité énergétique.
Selon les chiffres de la Cour, plus d’un million d’opérations ont été financées chaque année depuis 2021. Et de 2014 à 2020, le dispositif CEE « aurait permis de réduire de 106 TWh la consommation d’énergie en France en 2020, soit 6,5 % de celle-ci. »
En 2024, les CEE soutiennent près de 200 types de travaux d’économies d’énergie. Les entreprises, industries et ménages peuvent bénéficier d’aides CEE pour leurs travaux d’isolation thermique des bâtiments, la rénovation énergétique, le remplacement des équipements de chauffage, de régulation, d’eau chaude ou de ventilation (pompe à chaleur, thermostat, chaudière à haute performance énergétique, récupérateur de chaleur…) ou la mise en place d’un contrat de performance énergétique services.
Gagnez du temps !
N’hésitez pas à nous contacter, pour un accompagnement dans vos projets énergétiques !
Le dispositif des CEE a un impact direct sur les clients. Les fournisseurs répercutent sur les consommateurs le coût lié à l’obtention des certificats d’économies d’énergie.
La Cour des Comptes dénonce une taxe sur l’énergie masquée. En 2023, chaque ménage a ainsi contribué « à hauteur de 164 euros en moyenne au dispositif des CEE, soit un peu plus de 4 % du montant de ses factures d’énergie ».
Dès la fin de la troisième période des CEE, Tracfin, l’organisme du ministère de l’Économie et des Finances chargé de ces questions, a relevé une augmentation des fraudes liées aux certificats d’économies d’énergie.
Gonflement du montant des travaux, surestimation des économies d’énergie, travaux frauduleux … : malgré le renforcement des contrôles, ce dispositif laisse place à de multiples arnaques, en particulier dans le secteur du bâtiment. À l’image de ce qu’il s’est passé sur la taxe carbone, des réseaux d’escrocs profitent également du dispositif CEE, avec des entreprises montées de toutes pièces pour récupérer les fonds générés par les certificats.
Depuis sa création en 2005, le dispositif des CEE a connu de nombreuses évolutions. Le niveau d’obligation a augmenté. Des objectifs supplémentaires ont été ajoutés, comme le CEE précarité ou des bonifications temporaires pour soutenir des opérations précises (changement de chaudière, isolation des combles, pompe à chaleur).
Les règles « multiples et instables » aux yeux de la Cour des Comptes complexifient, fragilisent et opacifient le système.
Orienté vers plus d’efficacité, de transparence et de contrôle, le programme 2026-2030 se traduit par
Grâce au mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), vous pouvez financer vos travaux d’efficacité énergétique.
SirEnergies vous accompagne dans cette démarche !
Cliquez ci-dessous pour plus d’informations :

.png)

Un dépassement de puissance entraîne des pénalités financières et peut impacter le dimensionnement du contrat. Ajuster correctement la puissance souscrite permet d’éviter ces coûts supplémentaires.
.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.
.png)

En 2025, la France a atteint un solde exportateur net de 92,3 TWh, battant le précédent record de 2024 (89 TWh).
.png)

Le €/MWh est une unité de prix utilisée sur les marchés de gros, tandis que le kWh est l’unité visible sur vos factures.
.png)

Le processus repose sur l'utilisation de la force de l'eau (énergie cinétique) issue des courants, des chutes d'eau ou des dénivelés. Le fonctionnement suit trois étapes clés :
.png)

Oui, elle est considérée comme une énergie renouvelable à faibles émissions de gaz à effet de serre.
De plus, l'eau ne subit aucune transformation chimique durant le cycle de production et réintègre son milieu naturel en aval.
Cependant, la construction de barrages nécessite des mesures pour protéger les écosystèmes (débit minimum, passes à poissons).
.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.
.png)

Le transport (RTE) correspond aux "autoroutes" de l’électricité. Il s’agit de transporter de très grandes quantités d'énergie sur de longues distances, depuis les centrales de production (nucléaires, barrages, parcs éoliens offshore) vers les régions de consommation.
La distribution (Enedis) s'apparente aux "routes départementales" et aux rues. Elle récupère l'électricité à la sortie du réseau de transport pour la livrer directement chez le client final, en abaissant la tension pour qu'elle soit utilisable par vos appareils.
.png)

L'ARENH n'est pas remplacé par un dispositif unique, mais par une combinaison de mécanismes visant à stabiliser les prix.
Le principal est le Versement Nucléaire Universel (VNU), un système de redistribution qui s'appliquera à tous les consommateurs. Pour les très gros sites industriels (> 7 GWh/an), des contrats de long terme spécifiques, les CAPN (Contrats d’Allocation de Production Nucléaire), sont également proposés par EDF.
.png)

Ce record de 92,3 TWh s'explique par la conjonction de trois facteurs :
.png)

L'abondance de production française tire les prix du marché de gros vers le bas.
En vertu du mécanisme de l'Ordre de Mérite (Merit Order), les centrales les moins coûteuses (nucléaire, renouvelables) couvrent la demande plus souvent, évinçant les centrales à gaz ou charbon plus onéreuses.
Cela multiplie les épisodes de prix bas, voire négatifs, sur le marché spot.
.png)

La puissance souscrite doit être calculée en fonction du profil de consommation et des usages (chauffage, process industriels, équipements tertiaires). Une analyse fine permet d’assurer l’adéquation entre besoin réel et contrat.
.png)

Ce sont des signaux envoyés par RTE lors des périodes de tension sur le réseau électrique. L’outil Sirenergies vous informe en temps réel pour anticiper vos usages.
.png)

L'augmentation s'explique par la revalorisation de l'Accise sur le gaz à 16,39 €/MWh et la hausse de 3,41 % du tarif de transport (ATRT 8).
S'y ajoute l'entrée en vigueur des Certificats de Production de Biogaz (CPB), un nouveau coût réglementaire pour soutenir le biométhane.
Face à ces évolutions, Sirenergies vous accompagne dans l'achat de gaz naturel pour sécuriser vos prix malgré la volatilité du marché.
.png)

Oui, sous certaines conditions de taille.
Depuis le 1er février 2025, le critère de puissance a été supprimé.
Pour être éligible, votre entreprise ou collectivité doit compter moins de 10 salariés et réaliser un chiffre d’affaires (ou des recettes) inférieur à 2 millions d’euros.
.png)

Le kVA mesure la capacité maximale que votre compteur peut supporter à un instant T, tandis que le kWh mesure la quantité d'énergie consommée sur une durée.
.png)

C'est l'indicateur d'efficacité d'un appareil électrique ; il représente le ratio entre la puissance active (utile) et la puissance apparente (totale).
.png)

Le VNU repose sur les revenus excédentaires d'EDF.
Si les prix de marché dépassent les coûts de production du nucléaire (estimés à 60,3 €/MWh), EDF reverse une partie de ses profits à l'État.
.png)

Le sourcing consiste à identifier et analyser les offres de plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Cette démarche permet d’obtenir des contrats adaptés au profil de consommation et aux contraintes budgétaires de l’entreprise.
.png)

Parce que la puissance souscrite en kVA détermine le prix de l'abonnement et que tout dépassement peut entraîner des surcoûts importants.
.png)

L’industrie est concernée par la TICFE, la TICGN et d’autres contributions qui peuvent représenter une part importante des factures. Sirenergies identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour en bénéficier.
.png)

Cela permet de choisir le bon moment pour contractualiser, sécuriser vos budgets et anticiper les hausses.
.png)

Les entreprises du tertiaire doivent gérer leurs coûts d’énergie tout en garantissant le confort des usagers (bureaux, commerces, services). Les consommations sont souvent liées au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage, ce qui nécessite un suivi précis pour éviter les dérives budgétaires.
.png)

Les exploitations sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie leur application, identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour réduire la charge fiscale.
.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.
.png)

Les collectivités sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies analyse les factures, identifie les possibilités d’exonération et corrige les erreurs éventuelles pour réduire la charge fiscale.
.png)

Les entreprises tertiaires sont concernées par des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie l’exactitude des factures, identifie les exonérations possibles et aide à corriger les erreurs pour réduire durablement les coûts.
.png)

Le dispositif ARENH a laissé place au VNU (Versement Nucléaire Universel).
Ce changement structurel expose davantage les entreprises aux prix de gros, rendant la gestion des risques plus complexe qu'auparavant.
Il devient alors indispensable de définir une stratégie d'achat d'électricité avec Sirenergies pour lisser l'impact de la volatilité des marchés sur votre budget.
.png)

Un appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz afin d’obtenir des conditions contractuelles optimisées. C’est une démarche transparente qui permet de choisir l’offre la plus adaptée aux besoins budgétaires et techniques de l’organisation.

