

September 27, 2025
4
min de lecture
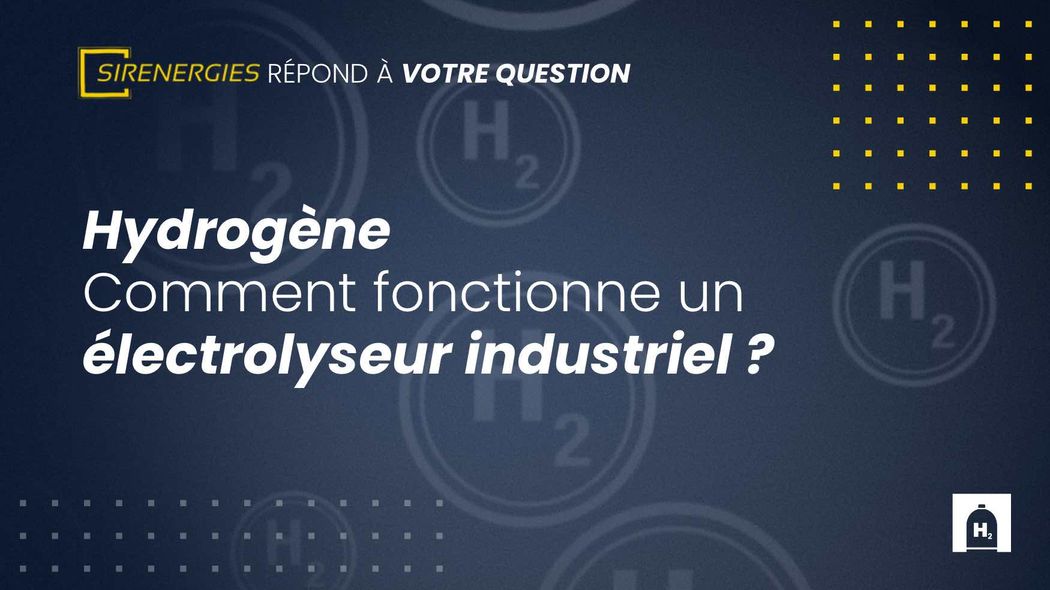
Dans le secteur des énergies renouvelables intermittentes, des termes comme « électrolyse », « hydrogène vert » et « électrolyseur d'hydrogène » prennent de l'ampleur. Considérée comme indispensable pour la transition écologique, la production d'hydrogène tend vers un processus de plus en plus respectueux de l'environnement.
Si de nombreux gouvernements et investisseurs placent leurs espoirs dans la mise en œuvre de l'hydrogène vert, son mode de production est encore méconnu du grand public.
Dans cet article, SirEnergies vous décrypte l'électrolyseur industriel et ses principales déclinaisons. Viendra aussi le temps de la question du futur pour la production d'hydrogène par électrolyse ?
L'électrolyseur d'hydrogène est simplement une pile à combustible inversée. Contrairement à la pile à combustible qui produit de l'électricité à partir de l'oxygène et de l'hydrogène, ce dispositif produit ces derniers grâce à l'électricité. Pour les moins scientifiques d'entre vous, voici une explication plus simple.
L'électrolyseur est un dispositif composé d'un récipient d'eau dans lequel se trouve un électrolyte. Il comprend aussi deux électrodes : une anode ou pôle positif et une cathode ou pôle négatif.
Une fois traversé par un courant électrique, l'électrolyseur induit une réaction chimique des deux côtés de l'électrolyte : c'est l'électrolyse. Cette réaction décompose progressivement les substances composées en d'autres substances composées ou singulières.
Résultat ? L'oxygène est libéré à l'anode et l'hydrogène est créé à la cathode. Ce dernier peut ensuite être transformé en hydrogène liquide grâce à un liquéfacteur.
Pour être viable sur le long terme, l’électrolyse de l’eau doit se baser sur une énergie durable. Nous pouvons citer entre autres :
Vous pouvez utiliser d'autres sources d'énergie pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Le résultat ne peut cependant pas être considéré comme de l'hydrogène vert.
La production d'hydrogène par électrolyse est un principe bien établi. Il existe cependant plusieurs systèmes pour y arriver, dont les principaux sont l'électrolyseur PEM et l'électrolyseur alcalin.
L'électrolyseur à membrane échangeuse de protons ou électrolyseur PEM fonctionne à la manière d'un filtre. La membrane polymère qui équipe ce dispositif ne laisse passer que les ions hydrogène.
Lors de la réaction d'électrolyse, les ions d'hydrogène et les électrons formés à l'anode traversent la paroi pour rejoindre la cathode. Ils se transforment en hydrogène à la cathode. Nous pouvons résumer les réactions chimiques avec les équations suivantes :
Anode : H2O → H2 + ½ O2 + 2e
Cathode : 2 h+ + 2e → H2
L'électrolyseur PEM a la particularité de pouvoir fonctionner sous pression. Il peut donc être plus petit que l'électrolyseur alcalin. Vous devez cependant tenir compte des exigences particulières qu'il requiert pour produire de l'hydrogène dans des conditions très acides.
Ce dispositif permet de produire de l'hydrogène à partir d'un électrolyte liquide alcalin. Vous pouvez utiliser de l'hydroxyde de sodium ou de potassium, car ces composés sont depuis longtemps connus pour leurs bons résultats.
Lors de la réaction chimique dans un électrolyseur alcalin, l'eau contenue dans l'électrolyte se subdivise en ions d'hydrogène et d'hydroxyde à la cathode. Ils entrent ensuite en contact avec une membrane avant d'être oxydés en oxygène et en eau à l'anode.
Nous pouvons résumer le bilan des réactions aux deux pôles de l'électrolyseur alcalin par les équations suivantes :
Cathode : 2 h 2 O + 2e → H2 + 2 OH -.
Anode : 2 OH - → ½ O2 + 2e- + H2O.
Bilan : H2O → H2 + ½ O2.
Voici quelques chiffres pour vous donner un meilleur aperçu des conditions nécessaires à la réalisation de cette réaction. Il faut environ :
Le principal avantage de l'électrolyseur alcalin est la grande disponibilité des électrolytes nécessaires à son fonctionnement. Il utilise cependant des cellules volumineuses, dont la densité de courant est relativement faible.
L'électrolyseur industriel n'a aucun intérêt s'il ne peut pas être utilisé sur le long terme pour couvrir les besoins énergétiques de la planète. Plusieurs entreprises se sont engagées dans cette voie pour mettre en place des infrastructures capables de relever les défis de demain.
La plus grande unité d'électrolyse à membrane a vu le jour au Québec. Inaugurée en janvier 2021 à Bécancour par Air Liquide, cette centrale est dotée de 4 unités distinctes. Elle fonctionne sur le principe de la membrane échangeuse de protons. Sa puissance totale de 20 MW en fait une référence mondiale.
La particularité de cet électrolyseur industriel ? La production d'hydrogène décarboné : il fonctionne avec de l'énergie renouvelable à 99 % ! De plus, l'installation peut produire jusqu'à 8,2 tonnes d'hydrogène bas carbone par jour. Pour vous donner une idée de son potentiel, il faut savoir que cette quantité est suffisante pour alimenter 16 000 chariots élévateurs ou encore 230 gros camions !
Le projet CEOG de McPhy est une innovation qui offre de l'espoir au stockage des énergies renouvelables intermittentes. Cette plateforme de production d'hydrogène permettra d'éviter l'émission d'environ 39 000 tonnes de CO2 chaque année par rapport à une centrale fossile.
L'ingénieux mécanisme à l'origine de ce projet ? La combinaison entre une électrolyse alcaline à une pression de 30 bars et des électrodes à haute densité de courant. La plateforme a une capacité de production d'environ 860 tonnes d'hydrogène vert par an pour une puissance totale de 16 MW.
Créé en mars 2021, le projet commun entre le CEA et la multinationale Schlumberger vise la production d'hydrogène à une grande échelle. La technologie utilisée est en cours de développement. Elle est néanmoins prometteuse, car elle repose sur l'électrolyse à haute température.
Genvia s'étend sur 600 m² à Béziers dans l'Hérault. Le site accueillera des équipements de pointe pour fabriquer les éléments constitutifs des stacks de puissance. Il s'agit d'un empilement répété du noyau de la réaction (cellule électrochimique) et d'une feuille métallique. Le rendement escompté ? 99 % en pouvoir calorifique supérieur (PCS) !
L'électrolyseur industriel fonctionne ainsi sur le principe de la séparation des composés chimiques d'un électrolyte pour produire de l'hydrogène. La nécessité de carburants de synthèse, les contraintes de taille des cellules et celles liées à leur densité de courant constituent des obstacles à l'essor de ce procédé de fabrication.

.png)

Un dépassement de puissance entraîne des pénalités financières et peut impacter le dimensionnement du contrat. Ajuster correctement la puissance souscrite permet d’éviter ces coûts supplémentaires.
.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.
.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.
.png)

Les collectivités sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies analyse les factures, identifie les possibilités d’exonération et corrige les erreurs éventuelles pour réduire la charge fiscale.
.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.
.png)

Parce que la puissance souscrite en kVA détermine le prix de l'abonnement et que tout dépassement peut entraîner des surcoûts importants.
.png)

Ce sont des signaux envoyés par RTE lors des périodes de tension sur le réseau électrique. L’outil Sirenergies vous informe en temps réel pour anticiper vos usages.
.png)

Les entreprises tertiaires sont concernées par des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie l’exactitude des factures, identifie les exonérations possibles et aide à corriger les erreurs pour réduire durablement les coûts.

