

September 27, 2025
7
min de lecture
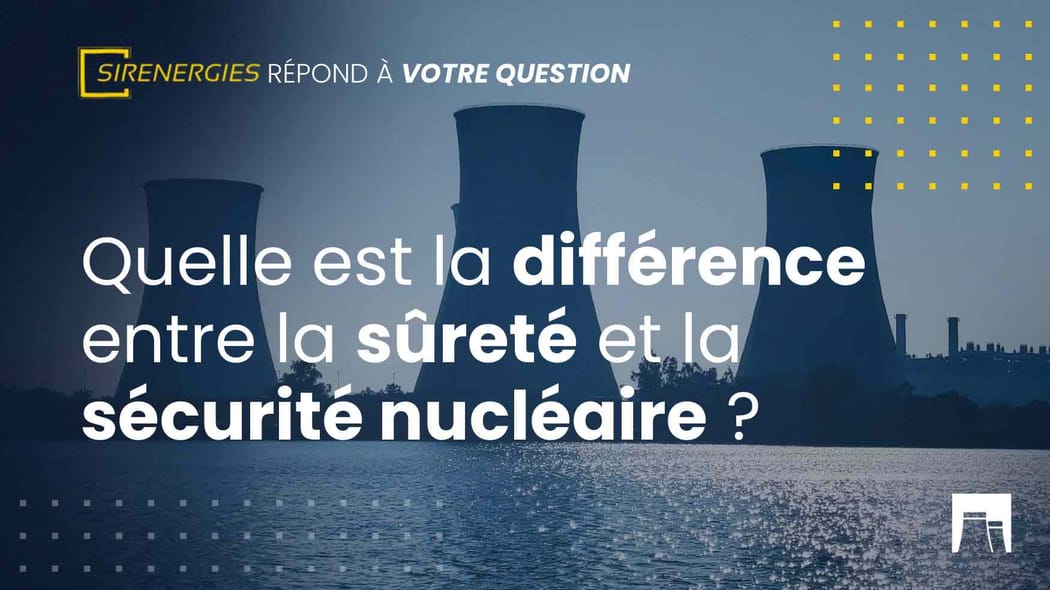
La France est le pays du nucléaire civil. Dès 1952, le premier plan quinquennal de développement de l’énergie nucléaire est voté. La construction des centrales nucléaires s’accélère à partir de 1974, année du premier choc pétrolier.
Aujourd’hui, l’énergie atomique est la première source de production d’électricité, avec 56 réacteurs en activité. Et, avec la construction annoncée de six EPR2 et l’émergence des réacteurs modulaires SMR, le nucléaire s’affirme comme une composante clé de la stratégie nationale vers la neutralité carbone.
Malgré cette longue histoire, le nucléaire inquiète. Très tôt, la France s’est dotée d’une organisation rigoureuse pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaires.
Souvent confondus, ces deux termes désignent des missions différentes, mais complémentaires, avec une finalité commune : la protection des personnes, de la santé de l’homme et de l’environnement. Décryptage.
La notion de sûreté nucléaire est définie en France par l’article 591-1 du Code de l’environnement et à l’international par l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique).
Dans le droit français, la sûreté nucléaire représente « l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets ».
Concrètement, selon l’AIEA, la sûreté nucléaire s’attache à maîtriser les risques à caractère involontaire, comme les incidents techniques dans les centrales ou les catastrophes naturelles.
Elle vise à sécuriser la conception et les conditions d’exploitation des installations nucléaires pour prévenir les risques de défaillance technique, les accidents et atténuer leurs conséquences.
Les mesures de sûreté nucléaire font l’objet d’une large information auprès du grand public, en application de la loi TSN de 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire.
La sûreté nucléaire concentre ses actions sur :
Le Code de l’environnement semble considérer la sécurité nucléaire comme une notion plus générique que la sûreté nucléaire. Mais, dans la réalité, elle désigne des missions bien définies, complémentaires à la sûreté.
Le Code de l’environnement définit la sécurité nucléaire comme une notion qui « comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident. »
En pratique, toujours selon l’AIEA, la sécurité nucléaire porte sur les risques d’origine volontaire, causés par des actes de malveillance (vols, sabotages, menaces terroristes, détournements de matières radioactives, accès non autorisés...).
Les mesures relatives à la sécurité nucléaire sont plus confidentielles que les mesures de sûreté nucléaire. Le risque est en effet de divulguer trop d’informations aux personnes malveillantes.
La sécurité nucléaire s’attache plus particulièrement à :
En matière de sûreté et de sécurité nucléaires, les principes d’organisation sont identiques, quel que soit le pays. Ils s’appuient sur la responsabilité des opérateurs, la désignation d’une autorité compétente, un système d’autorisation et un dispositif de contrôle.
Le cadre législatif et réglementaire affirme la responsabilité première des opérateurs nucléaires en matière de sûreté et de sécurité des installations. En France, cette responsabilité revient à EDF , unique exploitant du parc nucléaire.
Ainsi, l’exploitant doit :
En France, EDF dispose également d’une unité d’élite de secours : la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN). Sa mission : éviter qu’un accident nucléaire se transforme en catastrophe pour l’homme et son environnement.
Dispositif unique dans le monde, la FARN peut intervenir en moins de 24 heures en situation d’urgence pour remettre une centrale nucléaire en état de sûreté, assurer la protection des travailleurs et limiter les conséquences de l’accident nucléaire.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est l’autorité de contrôle du nucléaire en France depuis 2006.
Autorité administrative indépendante, l’ASN contrôle le niveau de sûreté des installations nucléaires et réglemente le transport des matières radioactives. Elle établit les prescriptions techniques et organisationnelles et s’assure du respect des normes et de la réglementation.
L’ASN surveille les centrales nucléaires tout au long de leur vie, de leur conception à leur démantèlement, en passant par leur construction, leur exploitation et leur mise à l’arrêt.
L’autorité réévalue régulièrement les risques nucléaires et peut imposer à l’exploitant des travaux de mise à niveau réglementaire et technique des installations.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire est épaulée par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
Pôle d’expertise technique et scientifique, l’IRSN analyse la sûreté des installations nucléaires, des infrastructures de transport des matières radioactives ou des centres de retraitement, de stockage et de gestion des déchets radioactifs. L’institut veille à ce que les dispositifs de sûreté et de radioprotection garantissent la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement.
L’IRSN exerce des activités de recherche-développement sur les risques nucléaires et radiologiques, pour renforcer la sûreté du nucléaire. Ses travaux portent par exemple sur la fusion du cœur, l’incendie en milieu confiné ou les impacts du vieillissement des matériaux.
Rattaché au ministère de la Transition écologique, le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) est le garant de la sécurité nucléaire en France, en lien avec les autres acteurs du nucléaire (ASN, IRSN, EDF…)
Autorisation de création ou de démantèlement des installations nucléaires, renseignement, gestion de crise, confidentialité et protection des informations sensibles, identification des menaces d’origine malveillante : l’État reste le principal acteur de la sécurité nucléaire.
Ses analyses aident à concevoir et dimensionner les systèmes de sécurité, déployés par les exploitants et contrôlés par l’ASN.
La sûreté et la sécurité nucléaires relèvent de la responsabilité des exploitants et des États. Mais l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) établit la réglementation internationale. Ses normes de sûreté et codes de conduite servent de socles aux législations et réglementations nationales.
Via des formations, l’AIEA aide ses États membres à appliquer les normes et à monter en expertise sur les risques nucléaires. L’agence internationale se réserve le droit d’inspecter et de contrôler les dispositifs nationaux de sécurité, de sûreté et de radioprotection.
Dans un contexte de relance du nucléaire civil, les parlementaires ont adopté le 9 avril 2024 le projet de loi ASNR. L’objectif : optimiser l’efficacité de la sûreté et la sécurité pour une maîtrise renforcée des risques nucléaires. La loi prévoit la création au 1er janvier 2025 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), née de la fusion de l’ASN et de l’IRSN.
Autorité administrative indépendante, l’ASNR reprendra les missions d’expertise, de recherche et de formation de l’ASN et de l’IRSN. Elle sera chargée du contrôle des installations nucléaires, de l’instruction des dossiers de sûreté et de la radioprotection.
Malgré son adoption, cette loi controversée continue à faire débat. Ses opposants dénoncent la perte d’indépendance et de transparence des experts et l’absence de distinction entre expertise et décision. Prochaine étape : l’avis du Conseil Constitutionnel avant promulgation.

.png)

Le kVA mesure la capacité maximale que votre compteur peut supporter à un instant T, tandis que le kWh mesure la quantité d'énergie consommée sur une durée.
.png)

Un appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz afin d’obtenir des conditions contractuelles optimisées. C’est une démarche transparente qui permet de choisir l’offre la plus adaptée aux besoins budgétaires et techniques de l’organisation.
.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.
.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.
.png)

Parce que la puissance souscrite en kVA détermine le prix de l'abonnement et que tout dépassement peut entraîner des surcoûts importants.
.png)

La puissance souscrite doit être calculée en fonction du profil de consommation et des usages (chauffage, process industriels, équipements tertiaires). Une analyse fine permet d’assurer l’adéquation entre besoin réel et contrat.
.png)

Les exploitations sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie leur application, identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour réduire la charge fiscale.
.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.

