

January 21, 2026
8
min de lecture

100 % des collectivités territoriales sont engagés dans au moins une opération de transition énergétique. Révélé par l’enquête Idex-Ipsos 2024, ce chiffre montre une vraie prise de conscience et une forte mobilisation des acteurs publics locaux.
Cette dynamique cache cependant des disparités et des lenteurs, freinée par de nombreux obstacles réglementaires, budgétaires, techniques et sociaux.
Comment les collectivités territoriales peuvent-elles surmonter ces défis pour bâtir un territoire plus sobre, solidaire et résilient ?
Sirenergies explore les leviers d’action et solutions innovantes pour accélérer et réussir la transition énergétique dans les territoires.
Les collectivités territoriales sont en première ligne de la transition énergétique.
Leur défi ? Construire des territoires plus durables en conciliant évolutions réglementaires, contraintes budgétaires, complexité administrative et acceptabilité sociale.
Depuis plus de trente ans, les textes législatifs et réglementaires renforcent le rôle exemplaire des collectivités dans la lutte contre le changement climatique. Placés au cœur de la transition énergétique, les territoires doivent composer avec des normes foisonnantes, en constante évolution.
Tout commence au Sommet de Rio en 1992, avec l’Agenda 21.
Cette démarche invite les collectivités à élaborer des plans de développement durable à l’échelle locale.
Depuis 2010, les lois s’enchaînent, avec la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en 2015, la loi Énergie-Climat et le décret tertiaire en 2019, la loi Climat et Résilience en 2021.

Les acronymes se multiplient aussi, entre:
Malgré leur volontarisme, les collectivités se heurtent à des réalités concrètes.
L’enquête Idex-Ipsos identifie plusieurs freins :
• Le manque de moyens financiers, avec la diminution des ressources propres et la dépendance accrue aux subventions : contraintes financièrement, les collectivités sont tiraillées entre le service public de court terme et les investissements d’avenir.
• La complexité administrative et réglementaire, symbolisée par le PCAET dont l’élaboration nécessite deux ans, pour un coût estimé à 120 000 euros.
• L’insuffisance de l’ingénierie face à la technicité croissante des projets et outils (tel le marché global de performance énergétique à paiement différé).
• La multiplicité des acteurs et des dispositifs.
Entre compétences attribuées, partagées, obligatoires, facultatives et déléguées, la compétence Énergie illustre le fameux « mille-feuille territorial ».
Les chevauchements et zones grises de responsabilité peuvent ralentir les politiques locales de transition énergétique et nuire à leur cohérence.
La transition énergétique suppose un changement profond des comportements et des modèles de développement.
Même s’ils sont compris et soutenus, les enjeux climatiques s’effacent parfois devant les priorités économiques et les préoccupations quotidiennes. Lorsqu’il s’agit d’investir, des thèmes - comme le pouvoir d’achat, la sécurité, la qualité des services publics ou la fiscalité -, peuvent primer sur les objectifs à long terme. Certains projets d’énergies renouvelables cristallisent particulièrement les oppositions, tels les parcs éoliens, les champs photovoltaïques ou la méthanisation.
Dans les territoires, la transition énergétique est bel et bien lancée. Face aux nombreux défis, plusieurs leviers d’action aident à accélérer la dynamique.
La première étape consiste à construire une stratégie globale pour donner de la cohérence aux initiatives locales, trop souvent fragmentées.
En 2023, l’ADEME constatait que seules 61 % des intercommunalités avaient adopté un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et qu’à peine 23 % d’entre elles avaient défini des actions concrètes et chiffrées.
Bâtir une stratégie claire et efficace passe par :
• La réalisation d’un diagnostic énergétique du territoire : l’État met à disposition des collectivités un outil gratuit pour centraliser les données énergétiques et mesurer l’impact des actions.
• La définition de scénarios de transition pour anticiper les besoins, évaluer les trajectoires possibles et coordonner les investissements.
• L’élaboration du PCAET à l’échelle intercommunale et l’alignement des stratégies des communes.
Les collectivités peuvent combiner plusieurs dispositifs pour financer leurs projets de transition énergétique. L’enquête Idex – Ipsos relève trois sources de financement plébiscitées :
• Le Fonds Vert, principale aide de l’État aux projets territoriaux de performance environnementale et adaptation au changement climatique.
• Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)
• Les subventions régionales et européennes, principalement le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
D’autres leviers financiers sont mobilisables, comme :
• Le Fonds chaleur, pour soutenir la production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération.
• Les partenariats public-privé et délégations de service public (DSP), qui attirent les capitaux privés tout en conservant la maîtrise des politiques publiques.
Privilégier des actions visibles, utiles et rentables à court terme aide à faire accepter la transition énergétique.
Les collectivités l’ont bien compris : 86 % ont engagé la rénovation énergétique des bâtiments publics. Au-delà de l’impact environnemental, ces chantiers apportent des bénéfices immédiats : réduction de la facture énergétique, amélioration du confort ou encore lutte contre la précarité énergétique.
Les collectivités disposent de nombreux autres leviers pour agir localement : la modernisation de l’éclairage public, les réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets, la mobilité décarbonée ou encore le photovoltaïque en toiture.
En misant sur des solutions concrètes qui s’intègrent naturellement au paysage, les collectivités démontrent qu’efficacité énergétique peut rimer avec besoins des citoyens et qualité de vie.
Pour réussir, la transition énergétique doit être partagée et co-construite.
Les success stories locales associent les citoyens tout au long de la conception des projets.
C’est l’approche adoptée par la métropole montpelliéraine.
Son Plan Lumière est aujourd’hui pleinement accepté grâce à une démarche participative active, qui permet d’ajuster finement l’éclairage public aux contraintes locales de sécurité, d’usages et de biodiversité.
Pour renforcer l’adhésion et l’acceptabilité sociale, les collectivités peuvent aussi soutenir les initiatives citoyennes, jouer un rôle de conseil et proposer des solutions accessibles (recyclage des déchets, aide à la rénovation énergétique...)
Ce lien de confiance durable facilite l’émergence de projets de production d’énergie décentralisée plus sensibles, comme la méthanisation ou les parcs d’énergies renouvelables.
Pour surmonter le manque d’ingénierie et gagner en efficacité, les collectivités disposent d’un réseau solide de partenaires publics et privés :
• L’expertise et le conseil aux collectivités proposés par les syndicats départementaux d’énergie dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité électrique ou la gestion des données énergétiques.
• La mutualisation des compétence par les intercommunalités, avec l’embauche d’un expert à disposition des communes membres.
• L’accompagnement à la transition énergétique du programme Territoire Engagé Transition Écologique de l’ADEME, pour structurer, valoriser et engager des actions locales.
• Les conseils et retours d’expérience des organismes spécialisés (Cerema, Agences Locales de l’Énergie et du Climat – ALEC, réseau Cler...)
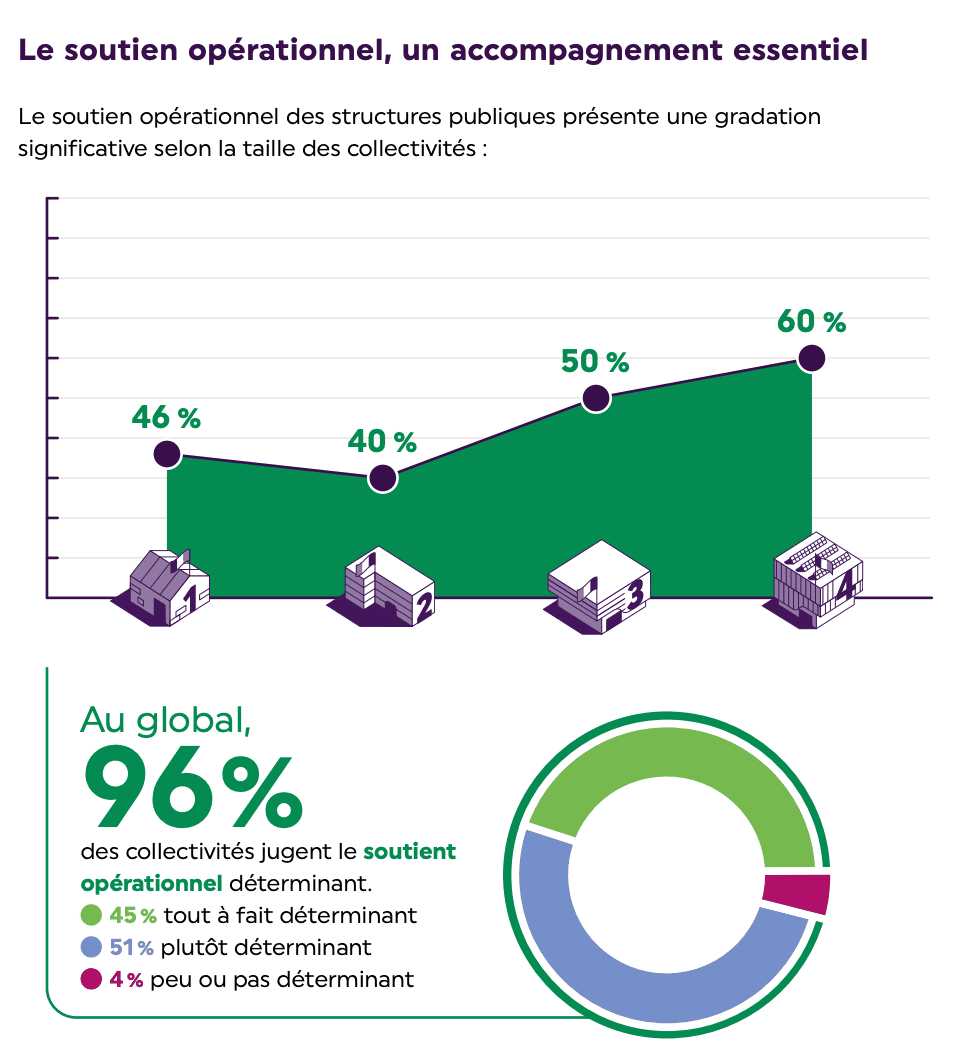
Parfois frileuses en la matière, les collectivités ne doivent pas hésiter à s’emparer des innovations technologiques pour optimiser leur transition énergétique.
Bien exploitées, les données sont une ressource précieuse pour cartographier les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre d’un territoire, identifier les actions pertinentes, suivre les progrès et ajuster les plans d’action.
Les outils numériques sont aujourd’hui de véritables outils d’aide à la décision, pour une planification énergétique plus fine, réactive et partagée. L’ouverture des données facilite la collecte d’informations, via :
• Les observatoires régionaux de l’énergie et du climat (OREC), qui collectent, agrègent et analysent les données environnementales pour produire des indicateurs et tableaux de bord dynamiques.
• Les plateformes d’open data, qui offrent un accès libre aux données énergétiques et environnementales d’un territoire (open data de la Métropole de Lyon ou de la région Occitanie).
• Les systèmes d’information géographique, développés par les collectivités.
Avec l’application Pilott de Sirenergies, suivez vos données énergétiques et bénéficiez de l’accompagnement d’un expert pour bâtir une stratégie de transition énergétique sur-mesure.

{{ask-pilott="/ctas"}}
Les smart cities, ou villes intelligentes, reposent sur la connexion des infrastructures publiques (bâtiments, éclairage public…) via des capteurs, des objets IoT et l’intelligence artificielle. Le suivi en temps réel des données permet d’optimiser en continu les consommations d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour exemple, les smart grids, ou réseaux électriques intelligents, ajustent la production et la distribution d’électricité aux besoins réels, gèrent les pics de consommation et facilitent l’intégration des énergies renouvelables.
En la matière, Issy-Les-Moulineaux et Lyon font figure de villes pionnières. Dès 2010, elles ont porté des projets expérimentaux pour optimiser leur éclairage public et piloter leurs consommations énergétiques.
Lyon a ciblé une priorité : fluidifier les déplacements intermodaux pour limiter la pollution de l’air.
Aujourd’hui, Angers Loire Métropole s’illustre par son projet ambitieux de smart city : plus de 50 000 capteurs suivent la qualité de l’air, régulent l’éclairage, gèrent la voirie ou détectent les fuites d’eau.
Les objectifs ?
Des économies d’énergie de 20 % dans les bâtiments publics et de 66 % sur l’éclairage public et une réduction de 30 % de la consommation d’eau des parcs publics.
Pour conclure…
Face au défi climatique, les collectivités territoriales sont au rendez-vous. Partout en France, elles multiplient les projets concrets, montent en compétences et recherchent des solutions innovantes. Mais, malgré cet engagement, le rythme de la transition énergétique reste trop lent. Le chemin est semé d’obstacles, entre financements insuffisants, complexité administrative, expertise limitée et acceptabilité sociale fragile.
Pour accélérer, les territoires devront combiner stratégie claire, financements pérennes, innovations technologiques et coopération locale. C’est à ces conditions que les collectivités pourront passer d’une sobriété souvent subie à une résilience planifiée, au service d’un développement durable, solidaire et souverain.

.png)

Il est possible de réduire votre facture énergétique de 10 à 15 % de manière immédiate sans réaliser de travaux lourds. Ces économies reposent exclusivement sur la sobriété énergétique et le changement de comportement des collaborateurs.
À titre d'exemple, le chauffage représente environ 50 % des consommations d'un bâtiment tertiaire : baisser la température de seulement 1°C permet de réduire la consommation de 7 %. De même, l'extinction systématique des lumières et la mise hors tension des équipements informatiques (ordinateurs, serveurs non critiques) permettent d'éliminer des gaspillages qui représentent souvent 40 % des dépenses inutiles.
.png)

La réussite d'un projet collectif énergie repose sur trois piliers fondamentaux :


.png)

Les bénéfices incluent des économies directes, une meilleure visibilité budgétaire et la conformité réglementaire. Sirenergies apporte également des solutions pédagogiques pour aider les élus et services techniques à mieux comprendre les contrats d’énergie.
.png)

Les collectivités sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies analyse les factures, identifie les possibilités d’exonération et corrige les erreurs éventuelles pour réduire la charge fiscale.
.png)

Les collectivités doivent sécuriser leurs contrats, maîtriser leurs budgets et respecter les obligations des marchés publics. Elles gèrent souvent de nombreux sites (écoles, bâtiments administratifs, éclairage public), ce qui rend le pilotage complexe sans accompagnement spécialisé.