

October 24, 2025
9
min de lecture
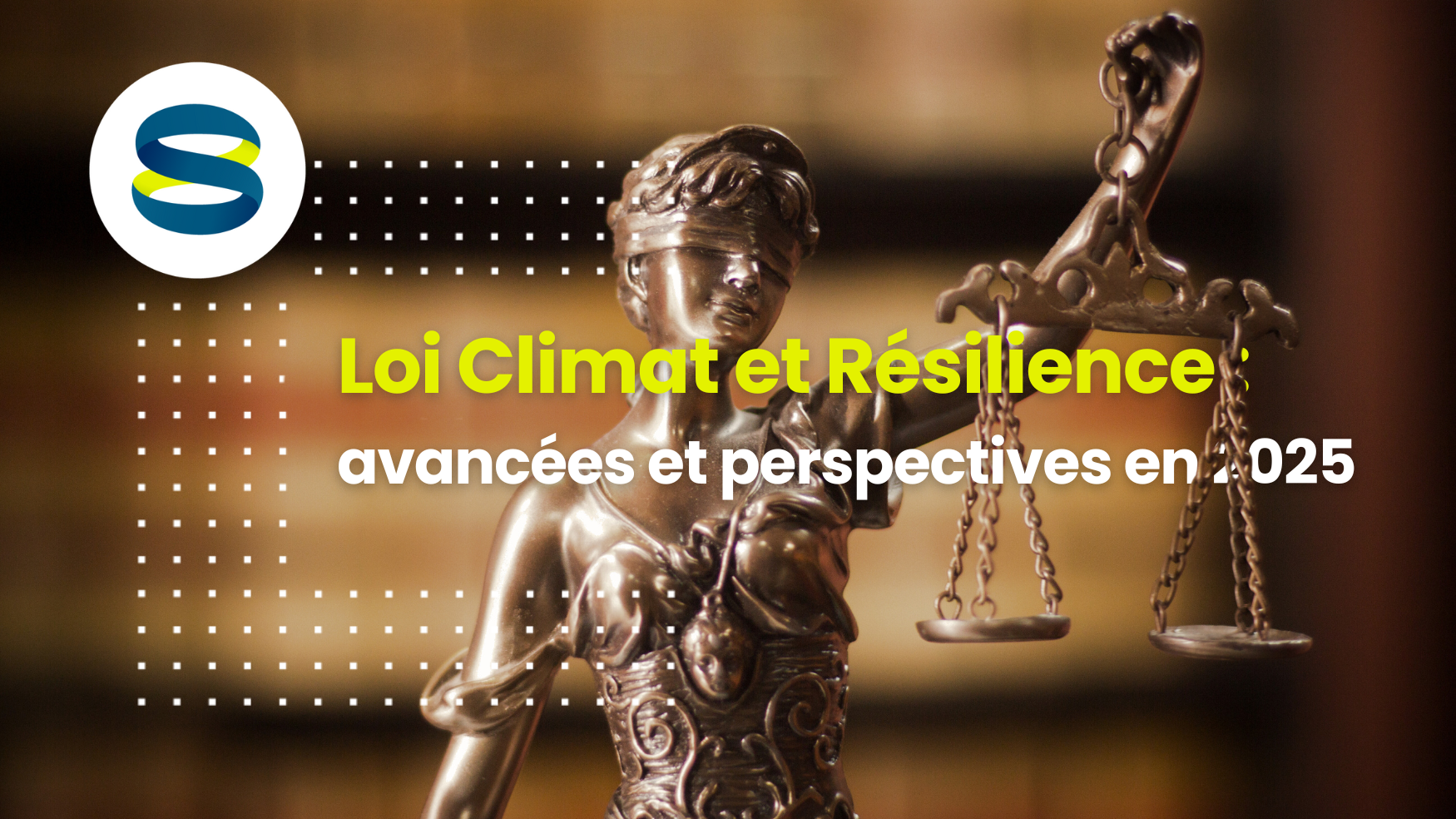
Promulguée le 22 août 2021, la loi Climat et Résilience dresse la feuille de route énergétique et environnementale de la France.
Portée par une ambition forte, elle entend engager l’ensemble de la société dans l’ère de la transition écologique, lutter contre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ses effets.
Depuis cinq ans, elle oriente les décisions publiques et se met en œuvre progressivement, au rythme des décrets d’application. Mais aujourd’hui, la loi est fragilisée.
Qu’est-ce que la loi Climat et Résilience ? Quelles en sont les principales mesures ? Où en est-on en 2025 ?
Entre avancées concrètes, reculs et résistances, la loi Climat et Résilience incarne les difficultés de concilier impératif écologique, justice sociale, contraintes économiques et intérêts partisans.

Promulguée le 22 août 2021, la loi Climat et Résilience se veut un tournant décisif dans la politique de décarbonation de la France. Dans un contexte national tendu, elle vise à concilier écologie et justice sociale pour une transition énergétique acceptable et acceptée.
La loi Climat et Résilience de 2021 s’inscrit dans la continuité des lois environnementales de 2015 (loi de transition énergétique pour la croissance verte - LTECV) et de 2019 (loi Énergie Climat). Elle élargit leur périmètre d’action, en s’inspirant des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), issue du grand débat national lancé par Emmanuel Macron après la crise des « gilets jaunes ».
Loi fleuve de 300 articles, la loi Climat et Résilience entend lutter contre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ses effets, tout en préservant la justice sociale.
Adoptée à une large majorité, la loi Climat et Résilience est une loi fondatrice de la stratégie énergétique nationale. Elle aligne l’État français sur l’objectif européen : diminuer d’au moins 55 % d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre (GES).
La loi introduit également un système d’évaluation permanent, placé sous la responsabilité du Haut Conseil pour le climat.
L’ambition législative est grande. Il s’agit d’impulser dans la société des transformations structurelles dans cinq domaines clés : consommation, production et travail, déplacement, logement et alimentation.
La loi Climat et Résilience consacre plusieurs articles à la consommation quotidienne et à l’alimentation. Ses premiers effets s’observent dans nos quotidiens.
La loi Climat et Résilience instaure l’affichage environnemental sur les biens de consommation. L’article 2 fixe l’objectif d’informer les consommateurs « de façon fiable et compréhensible » sur « l’impact environnemental des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie ».
Le premier décret d’application est attendu avant fin 2025 pour encadrer l’affichage dans le textile. Une consultation technique est en cours pour le secteur alimentaire. La généralisation de l’affichage aux cosmétiques et à l’ameublement doit suivre en 2027.
La loi Climat et Résilience encourage la réduction de la consommation de viande, dont la production est fortement émettrice de gaz à effet de serre.
Dans cette optique, depuis le 1er janvier 2023, les cantines universitaires et des établissements publics proposant plusieurs choix de menus ont l’obligation de proposer une option végétarienne. Cette mesure renforce la dynamique amorcée par la loi Egalim de 2018 qui impose un menu végétarien par semaine.
L’article 23 de la loi Climat et Résilience prévoit que les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m² de vente consacrent 20 % de leur superficie au vrac en 2030.
Une consultation sur le projet de décret s’est tenue début 2025, avec une priorité donnée aux produits alimentaires. Les cosmétiques et les détergents sont pour le moment écartés du périmètre de réflexion.
La loi encourage également la réparation, le réemploi, et le recyclage des produits. Un décret du 14 avril 2022 dresse la stratégie nationale pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique unique (stratégie 3R).
Interdite par l’article 7 de la loi Climat et Résilience, la publicité portant sur les énergies fossiles reste tolérée dans les faits. L’absence de décret d’application et de mécanisme de sanctions entretient le flou juridique.
La loi prévoit en effet qu’« un décret en Conseil d'État fixe la liste des énergies concernées par l’interdiction ainsi que les exigences attendues pour qu’une énergie renouvelable puisse faire l’objet d’actions de publicité ». Mais, si une consultation s’est déroulée en 2022, aucun texte n’a encore été publié.
Ce flou sur les publicités portant sur les énergies fossiles invite à observer avec prudence l’application de l’interdiction prévue en 2028 de la publicité sur les voitures les plus émettrices de CO₂...

La loi Climat et Résilience affirme avec force l’engagement de la France en faveur des énergies renouvelables et décarbonées. Cependant, sa mise en application se heurte à des résistances nationales et locales.
La loi Climat et Résilience impose aux entreprises d’équiper de panneaux photovoltaïques ou de végétaliser au moins 30 % de la surface de toiture de leurs bâtiments industriels et tertiaires. Le pourcentage monte à 40 % en 2026 et 50 % en 2027. Depuis 2023, toute nouvelle construction ou extension de plus de 500 m² d’emprise au sol est concernée.
L’article 83 facilite aussi l’adaptation territoriale de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et sa déclinaison en objectifs régionaux. Le décret d’application est cependant en attente de la publication de la PPE3.
Des mesures ont également été prises pour soutenir le développement des énergies décarbonées, comme l'hydroélectricité, le biogaz, l'hydrogène et les éoliennes.
Le saviez-vous ?
Sirenergies vous accompagne dans vos projets de transition énergétique : autoconsommation solaire, contrats d’énergie verte…).
Pour concrétiser vos objectifs tout en optimisant vos coûts énergétiques :
La loi Climat et Résilience renforce les objectifs de verdissement des flottes de véhicules fixés par la loi d’orientation des mobilités (LOM) en 2019. À partir de 2027, l’État doit atteindre une part de 70 % de véhicules à très faibles émissions lors du renouvellement de ses flottes. Les collectivités et les entreprises ont jusqu’en 2030 pour atteindre cet objectif, avec un jalon intermédiaire à 40 % respectivement en 2025 et 2027.
La loi soutient également le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Depuis le 1er janvier 2025, les parkings non-résidentiels et des grandes entreprises de plus de 250 salariés doivent disposer d’un point de recharge pour 20 emplacements.

Si la loi Climat et Résilience se veut ambitieuse sur les déplacements, force est de constater en 2025 la sensibilité du sujet, avec des mesures concrètes restreintes, voire supprimées.
L’incertitude sur les zones à faibles émissions (ZFE)
Adoptée par l’Assemblée Nationale le 17 juin 2025 dans le cadre du vote de la loi de simplification de la vie économique, la suppression des ZFE marque un revers de la loi Climat et Résilience.
Mesure phare de la loi de 2021, les zones à faibles émissions devaient permettre d’améliorer la qualité de l’air local en interdisant la circulation des véhicules les plus anciens. Mais cette mesure est emblématique de la difficulté de concilier écologie et justice sociale.
Le devenir des ZFE reste aujourd’hui incertain, suspendu à l’avis du Conseil Constitutionnel. Celui-ci pourrait en effet annuler la décision des députés, considérant la suppression des ZFE comme un « cavalier législatif » trop éloigné du sujet initial de la loi. Les villes pourraient aussi décider de contourner la loi en publiant des arrêtés municipaux.
Autre recul de la loi Climat et Résilience : l’interdiction des vols intérieurs courts quand il existe une alternative de train en moins de 2 h 30. Si cette mesure est bien entrée en vigueur, elle est restreinte par le décret d’application du 22 mai 2023.
En raison des nombreuses dérogations, la loi ne concerne que trois lignes aériennes reliant l’aéroport de Paris Orly aux villes de Nantes, Bordeaux et Lyon, soit 2,5 % du trafic aérien intérieur de la France. Si cette interdiction doit permettre d’éviter 55 000 tonnes d’émissions de CO₂ par an, cela représente une goutte d’eau par rapport aux 2,1 millions de tonnes de CO₂ générées par les vols intérieurs en 2019.
Parmi les bonnes nouvelles à retenir, la compensation carbone pour les vols intérieurs prévue à l’article 147 de la loi Climat et Résilience a été mise en place par le décret d’application d’avril 2022. Elle permet notamment de financer des projets agricoles et forestiers en France, sous le contrôle du ministère de la Transition écologique.
Relancée par la loi Climat et Résilience, l’écotaxe routière pour les poids lourds reste un sujet délicat. Au libre choix des Régions, sa mise en œuvre reste freinée par le souvenir du mouvement des « bonnets rouges » de 2013. Suite à la publication du décret d’application le 27 décembre 2023, seule la collectivité européenne d’Alsace envisage sa mise en place en 2027.
En revanche, une autre mesure de la loi Climat et Résilience remporte un succès timide, mais prometteur. L’article 124 permet l’expérimentation pour trois ans de voies réservées au covoiturage sur les autoroutes ou routes express. Fin 2023, 52 kilomètres étaient concernés sur l’ensemble du territoire national. Une expérimentation est en cours depuis le 3 mars 2025 sur le périphérique parisien et les autoroutes A1 et A13.
Dernière mesure à surveiller : la fin prévue en 2030 de la vente des véhicules particuliers neufs les plus polluants (émettant plus de 95 g de CO₂ par km). L’interdiction doit être étendue en 2040 aux véhicules lourds neufs roulant aux énergies fossiles.

Si les mesures relatives à l’urbanisme et au logement de la loi Climat et Résilience se mettent en place progressivement, elles restent menacées.
La loi Climat et Résilience fixe des objectifs ambitieux en matière d’artificialisation des sols : atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. Concrètement, toute construction doit être compensée par la renaturation d’une surface équivalente. La loi prévoit aussi 30 % d’aires protégées pour sanctuariser les zones naturelles protégées et sensibles.
Mais face aux difficultés rencontrées par les élus locaux, la loi est assouplie en mars 2025 par le Sénat, marquant un nouveau recul de la loi Climat et Résilience. Le nouveau texte valide des changements majeurs :
La loi Climat et Résilience acte l’interdiction progressive de la location des passoires thermiques. Depuis le 1er janvier 2025, tous les logements classés G au titre du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) sont interdits à la location. L’interdiction doit s’étendre en 2028 aux logements classés F, puis aux E en 2034.
Face à l’ampleur de la rénovation énergétique, des voix s’élèvent cependant pour réclamer l’assouplissement de la loi. En octobre 2024, le gouvernement de Michel Barnier évoquait un assouplissement du calendrier. Une proposition de loi a aussi été adoptée en avril 2025 en première lecture par le Sénat pour clarifier les conditions d’obligation des travaux énergétiques. Nul doute que la question devrait revenir prochainement au cœur du débat parlementaire.
À noter que le DPE collectif et l’obligation Plan Pluriannuel de Travaux (PPT), mis en place par la loi Climat et Résilience, s’appliquent progressivement aux copropriétés depuis 2023.
La loi Climat et Résilience marque une avancée majeure sur le plan juridique, en introduisant le délit d’écocide dans le Code de l’environnement.
Toute mise en danger de l’environnement peut être sanctionnée d’une amende de 250 000 euros et d’une peine de trois ans d'emprisonnement. Dans les cas les plus graves qualifiés d’écocide, les peines encourues montent jusqu’à 10 ans de prison maximum et 4,5 millions d’euros d’amendes pour les personnes physiques.
À ce jour, aucune condamnation n’a encore été prononcée en France pour écocide.
Pour conclure…
Quatre ans après sa promulgation, la loi Climat et Résilience incarne autant les espoirs que les tensions de la transition écologique en France.
Si certaines mesures concrètes commencent à transformer les usages - consommation, alimentation, logement, énergie, d’autres peinent à s’imposer ou reculent face aux pressions économiques, sociales ou politiques.
Face à l’urgence climatique, la France est aujourd’hui à la croisée des chemins.
Entre volonté de transformation, arbitrages complexes, inerties et résistances, elle doit prouver sa capacité à concilier ambitions environnementales et réalités de terrain, pour rendre la transition énergétique acceptable et bâtir un avenir durable pour tous.

.png)

La fin de l'ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) marque l'arrêt de la fourniture d'électricité à prix fixe garanti (42 €/MWh).
Dès le 1er janvier 2026, les entreprises sont exposées aux prix de marché, mais deux nouveaux mécanismes de régulation prennent le relais, bien que leur logique soit différente :
Conseil stratégique : Ne comptez pas sur le VNU pour réduire votre facture en 2026 si les marchés restent stables. Auditez vos contrats dès maintenant pour intégrer une part de prix fixe ou explorer des "Power Purchase Agreements" (PPA) pour sécuriser vos coûts sur le long terme.
.png)

Chaque modèle d'IA répond à un besoin spécifique du cycle d'achat :
L'expertise humaine reste néanmoins indispensable.
.png)

Absolument. La réforme des heures creuses vise à absorber la surproduction solaire en milieu de journée. Les créneaux d'heures creuses se déplacent progressivement vers la plage 11h00 – 17h00, notamment en été. C'est une opportunité majeure pour les sites industriels ou tertiaires capables de flexibilité.
Conseil stratégique :
.png)

Non. L'IA traite la donnée (data processing), mais l'analyste apporte la compréhension du contexte (market sentiment) et la prise de décision stratégique.
.png)

Le prix Forward est fixé à l'avance (sécurité budgétaire), tandis que le prix Spot varie heure par heure selon le marché (opportunité mais risque élevé).
.png)

Car les marchés dépendent de facteurs exogènes imprévisibles (géopolitique, météo soudaine, politique) que les modèles basés sur l'historique ne peuvent pas anticiper, tout comme on ne prédit pas le Loto.
.png)

La réussite d'un projet collectif énergie repose sur trois piliers fondamentaux :


.png)

Aux entreprises et collectivités qui souhaitent anticiper les obligations ESG, réduire leur empreinte carbone et structurer une stratégie climat.